
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. (…)
Liberté de conscience : histoire d’une notion et d’un droit; Dominique Avon; Annuaire de l'EPHE; Section des sciences religieuses; 2017; Volume 124; pp. 339-344
Le moment de rédaction de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) fut celui de la recherche d’un consensus inédit entre hommes et femmes, venus de divers horizons, sur le terrain de principes mettant l’être humain au cœur d’une représentation du monde. Composée d’un préambule et de trente articles, la DUDH fut adoptée, sans vote négatif et avec huit abstentions, par les membres de l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Son article 18 se présentait comme suit.
L'invention des institutions de la liberté en Europe : fragmentation politique, fragmentation territoriale et religion; François Facchini; Économie appliquée : archives de l'Institut de science économique appliquée; 2008, Volume LVI; Numéro 1; pp.71-106
Cet article soutient que l'invention du capitalisme et la généralisation du marché sont nés en Europe parce que le territoire européen était fragmenté et favorable au polycentrisme et à la concurrence institutionnelle (1), mais aussi parce que l'Europe avait été unifié entre le V° et X° siècle par la religion chrétienne qui portait un rapport au monde favorable à la reconnaissance de l'éthique de la liberté qui est ici pensée comme la condition idéologique nécessaire au développement économique d'une nation (2).
L’émergence des notions de tolérance et de liberté religieuses dans l'antiquité chrétienne; Gabriella Aragione; Revue d'histoire et de philosophie religieuses; 2019; Volume 99; Numéro 3
Au début de notre ère, les communautés chrétiennes se trouvent confrontées à des situations où le religieux génère des troubles. Théologiens et autorités politiques essayent de résoudre les conflits et de garantir un modus vivendi acceptable. Les notions de tolérance et de liberté religieuses émergent-elles alors ? On se propose ici de réfléchir à cette question controversée à partir de l’analyse des expressions censées véhiculer ces deux principes : tolerantia et libertas religionis.
De la tolérance à la liberté de religion: les pouvoirs face à la question protestante, France, 1685-1791; Luc Daireaux; Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest; 2018; Volume 125; Numéro 1; pp.59-70
Il s’agit ici d’interroger la tolérance non dans la seule perspective philosophique mais en termes juridiques et politiques. La communication revient sur le point de vue des autorités législatives et judiciaires françaises ainsi que sur le chemin, parfois sinueux, qui conduit au triomphe de la liberté de religion, dans le droit et la pratique, au tournant des années 1780-1790. Tout au long du xviiie siècle, confronté notamment à la persistance du protestantisme et à la multiplication des mariages et des enterrements illégaux, le pouvoir royal cherche à imaginer des solutions nouvelles, jusqu’au point de proposer un état civil pour les non catholiques, en 1787. La Révolution, sans épuiser le concept, renvoie cependant la tolérance au passé, celle d’une période sans liberté et sans égalité.
La liberté de religion dans le contexte du Traité de Lisbonne; Giorgio Feliciani; L'Année canonique; 2011; Volume liii; Numéro 1; pp.183-189
Pour affronter le thème proposé à l’attention de cette table ronde, il nous faut partir de l’article 10, n° 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui, on le sait, reconnaît à toute personne, sous le titre « Liberté de pensée, de conscience et de religion », le droit à telle liberté, en précisant que celui-ci « implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ».
La liberté d’expression face aux sentiments religieux : approche européenne; Ruth Dijoux, Julie Desrosiers; Cahiers de droit; 2012; Volume 53; Numéro 4; pp.861-876
La confrontation de la liberté d’expression et de la liberté religieuse soulève de nombreuses tensions. Pour certains, il convient de favoriser la liberté d’expression, fondement même d’une démocratie. Pour d’autres, au contraire, il convient de protéger la liberté de religion particulièrement contre la liberté d’expression. Afin de solutionner ces oppositions et de trouver un équilibre entre les libertés visées, le choix opéré par la Cour européenne des droits de l’homme, savoir le contrôle de proportionnalité, apparaît comme une solution efficace.
Liberté religieuse contre liberté d’expression? Pressions de conformité et rhétorique politiquement correcte; Guy Haarscher; Revue du droit des religions; 2020; Volume 10; pp.33-53
Les dangers que court la liberté d’expression ne sont pas toujours liés à des attaques frontales, comme l’est l’accusation de blasphème. De plus en plus souvent, la rhétorique liberticide se présente comme une illustration de la défense des droits de l’homme. Ainsi la liberté religieuse, le refus du discours de haine et le droit à la réputation (corrélatif de la notion de diffamation) – pour ne citer que ces trois notions – peuvent-ils servir à une mise en danger de la liberté d’expression. Péril quasi invisible pour qui ne critique pas sérieusement les concepts utilisés, puisque le « vilain mot » de blasphème n’est plus prononcé et que des concepts très politiquement corrects viennent à sa place jouer le rôle de « censeurs » de l’expression libre. Je voudrais dans le présent article fournir quelques éléments de déconstruction de cette rhétorique périlleuse pour les libertés.
Évolutions historiques : de l’appartenance à l’affiliation?; Brigitte Basdevant-Gaudemet
In
 L’affiliation religieuse en Europe
par
L’affiliation religieuse en Europe
par
Diversité religieuse et citoyenneté. Le port du foulard à l’école, perceptions croisées en France et au Royaume-Uni, de 1989 à aujourd’hui ; Marie-Annick Mattioli
In
 Sociétés inclusives et reconnaissance des diversités : Le nouveau défi des politiques d’éducation
par
Sociétés inclusives et reconnaissance des diversités : Le nouveau défi des politiques d’éducation
par
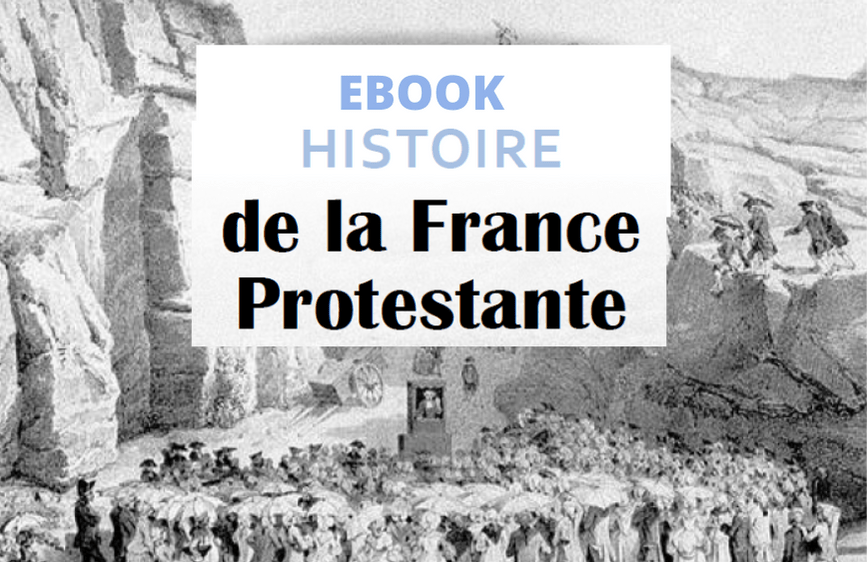 Histoire de la France protestante
par
Histoire de la France protestante
par
 Religious minorities, integration and the State;
par
Judaism, Christianity and Islam have coexisted in Europe for over 1300 years. The three monotheistic faiths differ in demography, in the moment of their arrival on the continent and in the unequal relations they maintain with power: Christianity was chosen by a large number of inhabitants and became — in spite of important differences according to place and time —a religion of state. The organization of the continent into states and the divisions within Christianity often placed minorities in an unstable and at times painful situation. This partially explains the fight against "heresies", the wars of religions, the expulsion of Jews from several European kingdoms (as well as the expulsion of Muslims from Sicily and the Iberian peninsula), the "Jewish question" in the 19th century up until the Holocaust. Since the 20th century, the debates concerning Islam and concerning public expression of religion are shaped in part by this past. The 13 studies gathered in this volume explore the ways in which states have treated their religious minorities. We study various policies — repression, supervision, integration, tolerance, secularization, indifference — as well as the many ways in which minorities have accommodated the majority’s demands. The relation is by no means one-sided: on the contrary, state policies have created resistance, negotiation (on the legal, political, and cultural fronts) or compromise. Through these precise and original examples, we can see how the protagonists (states, religious institutions, the elite, the faithful) interact, try to convince or influence each other in order to transform practices, invent and implement common norms and grounds, all the while knowing the confessional dimension of "religious" majority and minority does not fully embrace the identity of each citizen in full.
Religious minorities, integration and the State;
par
Judaism, Christianity and Islam have coexisted in Europe for over 1300 years. The three monotheistic faiths differ in demography, in the moment of their arrival on the continent and in the unequal relations they maintain with power: Christianity was chosen by a large number of inhabitants and became — in spite of important differences according to place and time —a religion of state. The organization of the continent into states and the divisions within Christianity often placed minorities in an unstable and at times painful situation. This partially explains the fight against "heresies", the wars of religions, the expulsion of Jews from several European kingdoms (as well as the expulsion of Muslims from Sicily and the Iberian peninsula), the "Jewish question" in the 19th century up until the Holocaust. Since the 20th century, the debates concerning Islam and concerning public expression of religion are shaped in part by this past. The 13 studies gathered in this volume explore the ways in which states have treated their religious minorities. We study various policies — repression, supervision, integration, tolerance, secularization, indifference — as well as the many ways in which minorities have accommodated the majority’s demands. The relation is by no means one-sided: on the contrary, state policies have created resistance, negotiation (on the legal, political, and cultural fronts) or compromise. Through these precise and original examples, we can see how the protagonists (states, religious institutions, the elite, the faithful) interact, try to convince or influence each other in order to transform practices, invent and implement common norms and grounds, all the while knowing the confessional dimension of "religious" majority and minority does not fully embrace the identity of each citizen in full.
 The Eve of Spain Myths of Origins in the History of Christian, Muslim, and Jewish Conflict
par
The Eve of Spain demonstrates how the telling and retelling of one of Spain’s founding myths played a central role in the formation of that country’s national identity. King Roderigo, the last Visigoth king of Spain, rapes (or possibly seduces) La Cava, the daughter of his friend and counselor, Count Julian. In revenge, the count travels to North Africa and conspires with its Berber rulers to send an invading army into Spain. So begins the Muslim conquest and the end of Visigothic rule. A few years later, in Northern Spain, Pelayo initiates a Christian resistance and starts a new line of kings to which the present-day Spanish monarchy traces its roots.Patricia E. Grieve follows the evolution of this story from the Middle Ages into the modern era, as shifts in religious tolerance and cultural acceptance influenced its retelling. She explains how increasing anti-Semitism came to be woven into the tale during the Christian conquest of the peninsula—in the form of traitorous Jewish conspirators. In the sixteenth century, the tale was linked to the looming threat of the Ottoman Turks. The story continued to resonate through the Enlightenment and into modern historiography, revealing the complex interactions of racial and religious conflict and evolving ideas of women’s sexuality.In following the story of La Cava, Rodrigo, and Pelayo, Grieve explains how foundational myths and popular legends articulate struggles for national identity. She explores how myths are developed around few historical facts, how they come to be written into history, and how they are exploited politically, as in the expulsion of the Jews from Spain in 1492 followed by that of the Moriscos in 1609. Finally, Grieve focuses on the misogynistic elements of the story and asks why the fall of Spain is figured as a cautionary tale about a woman’s sexuality.
The Eve of Spain Myths of Origins in the History of Christian, Muslim, and Jewish Conflict
par
The Eve of Spain demonstrates how the telling and retelling of one of Spain’s founding myths played a central role in the formation of that country’s national identity. King Roderigo, the last Visigoth king of Spain, rapes (or possibly seduces) La Cava, the daughter of his friend and counselor, Count Julian. In revenge, the count travels to North Africa and conspires with its Berber rulers to send an invading army into Spain. So begins the Muslim conquest and the end of Visigothic rule. A few years later, in Northern Spain, Pelayo initiates a Christian resistance and starts a new line of kings to which the present-day Spanish monarchy traces its roots.Patricia E. Grieve follows the evolution of this story from the Middle Ages into the modern era, as shifts in religious tolerance and cultural acceptance influenced its retelling. She explains how increasing anti-Semitism came to be woven into the tale during the Christian conquest of the peninsula—in the form of traitorous Jewish conspirators. In the sixteenth century, the tale was linked to the looming threat of the Ottoman Turks. The story continued to resonate through the Enlightenment and into modern historiography, revealing the complex interactions of racial and religious conflict and evolving ideas of women’s sexuality.In following the story of La Cava, Rodrigo, and Pelayo, Grieve explains how foundational myths and popular legends articulate struggles for national identity. She explores how myths are developed around few historical facts, how they come to be written into history, and how they are exploited politically, as in the expulsion of the Jews from Spain in 1492 followed by that of the Moriscos in 1609. Finally, Grieve focuses on the misogynistic elements of the story and asks why the fall of Spain is figured as a cautionary tale about a woman’s sexuality.
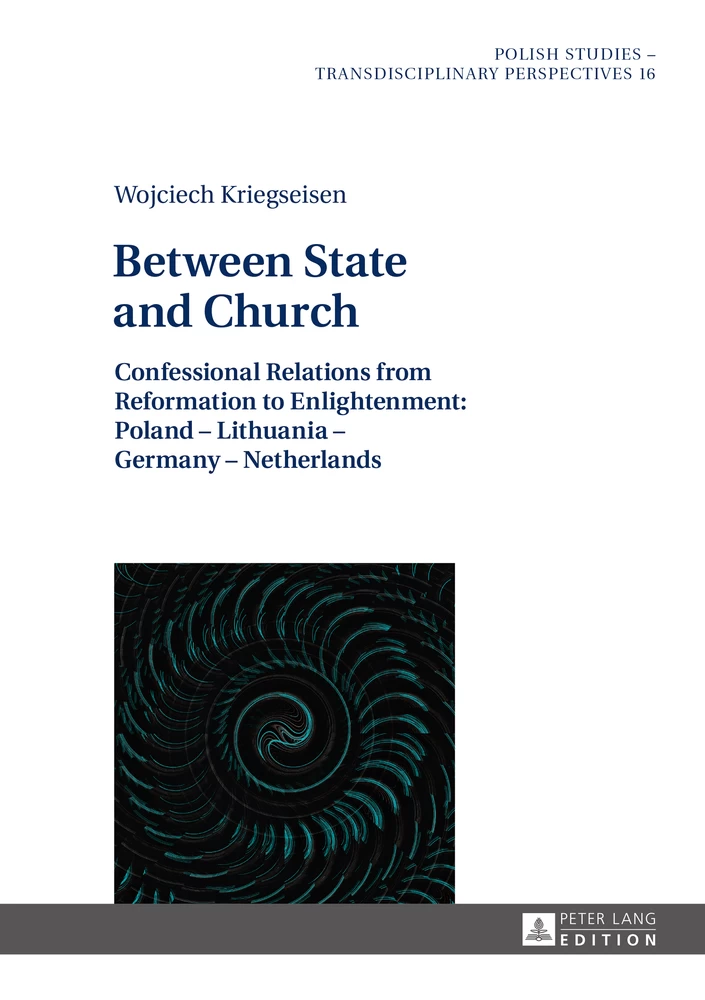 Between State and Church. Confessional Relations from Reformation to Enlightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands
par
The different theoretical notions and practices of the relations between the state and religious communities in early modern Europe constitute one of the most interesting problems in historiography. Moving away from a simple #65533;toleration#65533; versus #65533;non-toleration#65533; dichotomy, the author sets out to analyse the inter-confessional relations in selected European territories in a #65533;longue duree#65533; perspective, between Reformation and Enlightenment. Outlining the relations between the state and the different Churches (confessions) in the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Holy Roman Empire of Germany, and the Northern Netherlands serves to highlight the specificity of Northern Netherlands serves to highlight the specificity of #65533;free#65533; (non-absolutist) composite states, where the particularly complex process of defining the raison d'etat determined the level of religious toleration that was politically feasible and socially acceptable.
Between State and Church. Confessional Relations from Reformation to Enlightenment: Poland – Lithuania – Germany – Netherlands
par
The different theoretical notions and practices of the relations between the state and religious communities in early modern Europe constitute one of the most interesting problems in historiography. Moving away from a simple #65533;toleration#65533; versus #65533;non-toleration#65533; dichotomy, the author sets out to analyse the inter-confessional relations in selected European territories in a #65533;longue duree#65533; perspective, between Reformation and Enlightenment. Outlining the relations between the state and the different Churches (confessions) in the Polish-Lithuanian Commonwealth, the Holy Roman Empire of Germany, and the Northern Netherlands serves to highlight the specificity of Northern Netherlands serves to highlight the specificity of #65533;free#65533; (non-absolutist) composite states, where the particularly complex process of defining the raison d'etat determined the level of religious toleration that was politically feasible and socially acceptable.
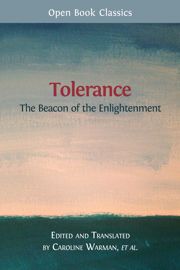 Tolerance. The Beacon of the Enlightenment
par
Inspired by Voltaire’s advice that a text needs to be concise to have real influence, this anthology contains fiery extracts by forty eighteenth-century authors, from the most famous philosophers of the age to those whose brilliant writings are less well-known. These passages are immensely diverse in style and topic, but all have in common a passionate commitment to equality, freedom, and tolerance. Each text resonates powerfully with the issues our world faces today. Tolerance was first published by the Société française d’étude du dix-huitième siècle (the French Society for Eighteenth-Century Studies) in the wake of the Charlie Hebdo assassinations in January 2015 as an act of solidarity and as a response to the surge of interest in Enlightenment values. With the support of the British Society for Eighteenth-Century Studies, it has now been translated by over 100 students and tutors of French at Oxford University.
Tolerance. The Beacon of the Enlightenment
par
Inspired by Voltaire’s advice that a text needs to be concise to have real influence, this anthology contains fiery extracts by forty eighteenth-century authors, from the most famous philosophers of the age to those whose brilliant writings are less well-known. These passages are immensely diverse in style and topic, but all have in common a passionate commitment to equality, freedom, and tolerance. Each text resonates powerfully with the issues our world faces today. Tolerance was first published by the Société française d’étude du dix-huitième siècle (the French Society for Eighteenth-Century Studies) in the wake of the Charlie Hebdo assassinations in January 2015 as an act of solidarity and as a response to the surge of interest in Enlightenment values. With the support of the British Society for Eighteenth-Century Studies, it has now been translated by over 100 students and tutors of French at Oxford University.
Religious liberty and Economic prosperity: Four lessons From the past; Anthony Gill; John M. Owen; The Cato Journal; 2017: Volume 37; Issue 1; pp.115-134
Many political scientists and economists have argued that expanded civil liberties and general political freedom are conducive to economic growth (e.g., Smith [1776] 1976; North, Wallis, and Weingast 2009). One subset of these civil liberties—religious freedom—is frequently neglected in such discussions, with scholars tending to focus on the rights of private property ownership, contracting, assembly, and access to political decisionmaking. Religious liberty is often seen as an isolated freedom that directly impacts parishioners and clerics but has little spillover effects on the general economy or society. But can the right to worship freely also have positive consequences for economic growth? A casual glance suggests nations that have developed strong legal guarantees of religious freedom (and a concomitant culture of religious toleration) are also ones that have had long-term sustained economic growth? A casual glance suggests nations that have developed strong legal guarantees of religious freedom (and a concomitant culture of religious toleration) are also ones that have had long-term sustained economic growth (Grim and Finke 2011).
Religion and Discrimination: A Review Essay of Persecution and Toleration: The Long Road to Religious Freedom; SriyaI Iyer, Journal of Economic Literature; 2022; Volume 60; Issue 1; pp.256-278
Noel D. Johnson and Mark Koyama’s book, Persecution and Toleration: The Long Road to Religious Freedom, examines the links between religion, state action, and the development of liberalism in medieval Europe. It discusses a model of “conditional toleration”; how the interaction between religion and state influences persecution and discrimination against minorities; and how religious freedom eventually paved the way for scientific advances, liberalism, and economic growth. It tackles issues such as fiscal capacity, anti-Semitism in Europe, plagues including the Black Death, heresy in the Spanish Inquisition, witchcraft trials, the Holocaust, climate shocks, and the growth of cities with emergent religious minorities. It discusses these issues for a range of countries in medieval Europe, providing rich historical detail and interpretive depth for its main argument. This is a deeply evocative book that makes an important contribution to the new economics of religion. Carefully researched and thoughtfully crafted, the themes it discusses and the ideas it raises have relevance not only for medieval European societies, with which it is principally concerned, but also for contemporary economies everywhere.
The Legal Status of Religious Minorities in the Euro-Mediterranean World (RELMIN); John Tolan; Approaches to Comparison in Medieval Studies; Medieval Worlds; 2015; Volume 1; pp.148-166
One of the key challenges facing Europe since the end of the Second World War has been to confirm and protect the rights of minority religious groups: Jews in particular, but also Catholics or Protestants (in countries where one or the other group is a minority) and members of other religions who have immigrated into the European Union: Muslims, Buddhists, Hindus, Sikhs and others. (…)The issues of religious diversity and of the regulation of pluralistic European societies are not new. On the contrary, religious diversity in Europe is grounded in the practice of Christian and Muslim states of the European Middle Ages. In the Christian Roman Empire of the fifth and sixth centuries, emperors banned paganism yet allowed Jews limited freedoms, creating a protected but subordinate status for the empire's Jewish subjects. In the wake of the Muslim conquests of much of the former Roman/Byzantine Empire, Muslim rulers accorded to Jews and Christians the status of dhimmīs, protected minorities that enjoyed broad religious freedoms and judicial autonomy, but whose social and political status was inferior to that of Muslims. In Christian kingdoms of medieval Europe, Jews (and in some cases Muslims) were accepted as subordinate minorities who could maintain their synagogues and mosques and openly practice their religions. Towards the end of the Middle Ages, the status of these religious minorities became increasingly precarious in many European states (...).
 Revue du Droit des Religions
par
Revue du Droit des Religions
par
 Histoire des croyances et des idées religieuses. I, De l'âge de pierre aux mystères d'Éleusis
par
Les trois tomes de l'Histoire des croyances et des idées religieuses représentent une oeuvre irremplaçable. L'érudition et la puissance intellectuelle synthétique de Mircea Eliade apportent au lecteur une vision des religions qui fait apparaître à la fois l'unité fondamentale des phénomènes religieux et l'inépuisable nouveauté de leurs expressions. Le tome I, De l'âge de pierre aux Mystères d'Éleusis, nous conduit des premiers comportements magico-religieux préhistoriques à l'épanouissement du culte de Dionysos, à travers les religions mésopotamiennes et de l'Égypte ancienne, la religion d'Israël, la religion des Indo-Européens, les religions de l'Inde avant Bouddha, la religion grecque et la religion iranienne.
Histoire des croyances et des idées religieuses. I, De l'âge de pierre aux mystères d'Éleusis
par
Les trois tomes de l'Histoire des croyances et des idées religieuses représentent une oeuvre irremplaçable. L'érudition et la puissance intellectuelle synthétique de Mircea Eliade apportent au lecteur une vision des religions qui fait apparaître à la fois l'unité fondamentale des phénomènes religieux et l'inépuisable nouveauté de leurs expressions. Le tome I, De l'âge de pierre aux Mystères d'Éleusis, nous conduit des premiers comportements magico-religieux préhistoriques à l'épanouissement du culte de Dionysos, à travers les religions mésopotamiennes et de l'Égypte ancienne, la religion d'Israël, la religion des Indo-Européens, les religions de l'Inde avant Bouddha, la religion grecque et la religion iranienne.
 Histoire des croyances et des idées religieuses. II, De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme
par
Les trois tomes de l'Histoire des croyances et des idées religieuses représentent une oeuvre irremplaçable. L'érudition et la puissance intellectuelle synthétique de Mircea Eliade apportent au lecteur une vision des religions qui fait apparaître à la fois l'unité fondamentale des phénomènes religieux et l'inépuisable nouveauté de leurs expressions. Le tome II, De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme, est consacré en grande partie aux religions de la Chine ancienne, au bouddhisme, ainsi qu'à la naissance du christianisme.
Histoire des croyances et des idées religieuses. II, De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme
par
Les trois tomes de l'Histoire des croyances et des idées religieuses représentent une oeuvre irremplaçable. L'érudition et la puissance intellectuelle synthétique de Mircea Eliade apportent au lecteur une vision des religions qui fait apparaître à la fois l'unité fondamentale des phénomènes religieux et l'inépuisable nouveauté de leurs expressions. Le tome II, De Gautama Bouddha au triomphe du christianisme, est consacré en grande partie aux religions de la Chine ancienne, au bouddhisme, ainsi qu'à la naissance du christianisme.
 Histoire des croyances et des idées religieuses. III, De Mahomet à l'âge des Réformes
par
Les trois tomes de l’Histoire des croyances et des idées religieuses représentent une œuvre irremplaçable. L’érudition et la puissance intellectuelle synthétique de Mircea Eliade apportent au lecteur une vision des religions qui fait apparaître à la fois l’unité fondamentale des phénomènes religieux et l’inépuisable nouveauté de leurs expressions.Le tome III, De Mahomet à l’âge des réformes, poursuit, de saint Augustin au siècle des Lumières, l’histoire des Églises chrétiennes commencée dans le volume précédent. Il étudie également Mahomet et l’essor de l’islam, et consacre plusieurs chapitres aux mystiques juive, chrétienne et musulmane. Il aborde enfin les hérésies, les pratiques populaires et l’ésotérisme, jusqu’à l’époque des Réformes. S’y ajoutent deux chapitres consacrés aux religions eurasiennes et tibétaines
Histoire des croyances et des idées religieuses. III, De Mahomet à l'âge des Réformes
par
Les trois tomes de l’Histoire des croyances et des idées religieuses représentent une œuvre irremplaçable. L’érudition et la puissance intellectuelle synthétique de Mircea Eliade apportent au lecteur une vision des religions qui fait apparaître à la fois l’unité fondamentale des phénomènes religieux et l’inépuisable nouveauté de leurs expressions.Le tome III, De Mahomet à l’âge des réformes, poursuit, de saint Augustin au siècle des Lumières, l’histoire des Églises chrétiennes commencée dans le volume précédent. Il étudie également Mahomet et l’essor de l’islam, et consacre plusieurs chapitres aux mystiques juive, chrétienne et musulmane. Il aborde enfin les hérésies, les pratiques populaires et l’ésotérisme, jusqu’à l’époque des Réformes. S’y ajoutent deux chapitres consacrés aux religions eurasiennes et tibétaines
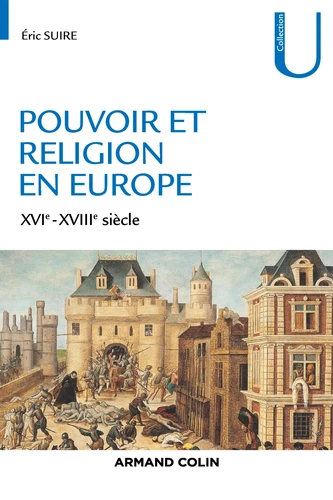 Pouvoir et religion en Europe : XVIe-XVIIIe siècle
par
Si le religieux n'est pas censé aujourd'hui interférer avec le politique, dans l'Europe moderne, la religion - le christianisme - était structurante et commandait à tout et tous.Trois principes ont façonné les rapports entre Églises et États : l'autorité vient de Dieu, les pouvoirs temporel et spirituel sont indépendants, les fins humaines sont subordonnées aux spirituelles. Ce cadre assez large a permis des politiques différentes. Déstabilisées par les réformes du XVIe siècle, les monarchies ont su tirer profit de la dislocation de la Chrétienté latine, abandonnant la guerre religieuse pour la raison d'État. Aux siècles suivants, le scepticisme religieux et l'essor du rationalisme contribuent autant à extraire la religion du champ politique qu'à asseoir la tutelle de l'État sur l'Église.
Pouvoir et religion en Europe : XVIe-XVIIIe siècle
par
Si le religieux n'est pas censé aujourd'hui interférer avec le politique, dans l'Europe moderne, la religion - le christianisme - était structurante et commandait à tout et tous.Trois principes ont façonné les rapports entre Églises et États : l'autorité vient de Dieu, les pouvoirs temporel et spirituel sont indépendants, les fins humaines sont subordonnées aux spirituelles. Ce cadre assez large a permis des politiques différentes. Déstabilisées par les réformes du XVIe siècle, les monarchies ont su tirer profit de la dislocation de la Chrétienté latine, abandonnant la guerre religieuse pour la raison d'État. Aux siècles suivants, le scepticisme religieux et l'essor du rationalisme contribuent autant à extraire la religion du champ politique qu'à asseoir la tutelle de l'État sur l'Église.
Les livres peuvent être consultés sur demande (envoyée au Library@europarl.europa.eu) à:
Info Hub Bruxelles
Esplanade Solidarność 1980,
B-1050 Bruxelles, Belgique
Du lundi au vendredi 9:00-18:00
+32 2 28 48077
Le catalogue de la bibliothèque du PE vous donnera accès à une vaste collection multilingue de sources d'information, axées sur les politiques européennes, le droit, l'économie et les relations internationales. Trouvez des résultats de recherche (accès libre) liés au sujet de ce guide.
Grâce à la Citizens' App, vous découvrirez qui fait quoi dans l’Union, en quoi tout cela vous concerne dans votre vie quotidienne et quels sont les défis auxquels l’Union est confrontée, dont bon nombre façonneront votre avenir.
Si vous désirez en savoir plus sur les activités, les compétences et l’organisation du Parlement européen, vous pouvez joindre l’unité «Demandes d’informations des citoyens» grâce à ce formulaire.
*À l'exception de certaines images